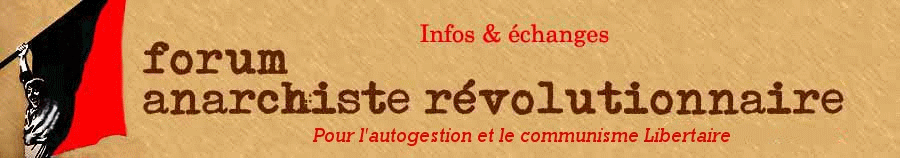Anatomie d’un projet par Benoît Borrits

http://www.autogestion.asso.fr/?p=5689Le titre « Coopératives contre capitalisme » indique de la part de l’auteur l’intention de ne rester ni aux mouvements coopératifs comme solutions ponctuelles et locales, répondant la plupart du temps au défaut de capitalistes, ni à la seule addition de ces mouvements comme solution globale. Le titre annonce le prisme par lequel Benoît Borrits analyse minutieusement ce qui est déjà à l’œuvre dans la société.
Si l’auteur fait la démonstration du caractère actuel de la nécessité de s’engager vers une appropriation collective des grands moyens de production, à l’aide d’exemples positifs, je retiendrai personnellement, un exemple qui en illustre tant d’autres, où au contraire, la question a fait défaut. J’ai en mémoire les deux types de réactions quand Mittal a décidé de larguer les amarres d’Arcelor: celle des salariés, précisant que Mittal n’avait jamais mis le nez dans le concret de la production d’acier – qu’ils s’étaient débrouillés tout seuls (cela c’est moi qui l’ajoute), et ils en tiraient la conclusion …qu’il fallait un repreneur et n’envisageaient pas de s’y substituer collectivement. Dans la même période, Montebourg, alors ministre, répondait à un journaliste, « qu’en matière de nationalisation, l’Etat n’était pas un bon gestionnaire »… « Mais qui parle d’Etat ? » aurait rétorqué Benoît Borrits. Et d’aborder la différence entre nationalisation, version étatique, telle que le XXème siècle nous l’a légué, forme soviétique ou française, et appropriation sociale.
Il montre la différence de logique entre une entreprise pilotée par la logique des actionnaires ou par celle pilotée par ceux qui ne sont alors plus tout à fait des salariés. Mais est-ce que l’addition des entreprises mises en coopérative suffit à faire de l’appropriation sociale ? C’est dit-il le « verre de vin à moitié plein ». Comment empêcher que chacune d’elle ne se fasse récupérer par des logiques qui lui sont contraires et comment peuvent-elles « coopérer entre elles au point de régler la production selon un plan commun ? » «La meilleure réponse est la généralisation des reprises d’entreprises en coopérative de travail».
L’analyse de conditions de production montre que le compromis de classes qui avait longtemps prévalu, est devenu impossible. Cela souligne la nécessité d’orienter les luttes vers autre chose et conduit l’auteur vers la recherche de « transition ». Le point névralgique en est le concept de cotisation. La nécessité réside dans le fait qu’il existe des services et des politiques publiques qui ont besoin d’être financés. La possibilité réside dans une mutualisation des plus-values, qui permet cohérence et péréquation. C’est partiellement déjà le cas : sur quelle valeur ajoutée marchande finance-t-on l’Education nationale ? Pour électrifier les campagnes et les zones de montagnes, EDF a fourni du travail à perte, au sens marchand du terme (ces exemples sont de moi). Evidemment, pour une telle politique et une augmentation des salaires, il ne faut pas compter sur l’abnégation des actionnaires et mieux vaut se fier aux salariés (et aux usagers ajoute le dernier chapitre) ce qui suppose droits et pouvoir sur l’entreprise. Ce principe de la cotisation ne se limite pas aux salaires et au « social » mais participe aux investissements. On en trouve déjà des ébauches dans des projets syndicaux ou d’associations, précise l’auteur. Un tel fonds, en dépassant l’horizon de la revendication salariale « préfigure une appropriation collective des moyens de production ». Vient alors une étude précise des rapports entre salaires, garanties sociales, cotisations à partir des profits des entreprises et de la péréquation rendue possible.
Le travail de Benoit Borrits ne se situe pas dans l’abstrait : à partir des expériences dont il prône la généralisation, il interroge directement les impasses actuelles de « la gauche de gauche » et du syndicalisme. Il met sur le métier des questions qui pourraient faire sauter des verrous de la situation actuelle, pourvu que l’on s’y affronte.
Le livre se termine sur un appel à une suite : la coopérative ne peut se suffire à elle-même et il s’agit de produire du commun. Quid alors d’un dépassement de la dissociation travail/activités dites hors travail, de l’émancipation et autoproduction de pouvoir et du dépassement progressif de l’Etat ? Dans un second tome ?