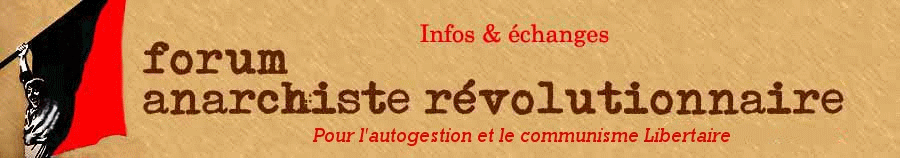Fiscalité : travailler à une alternative
Une version complétée et légèrement modifiée d’un texte de la Commission Économie des Alternatifs, publié dans le dernier Rouge et Vert
Les dernières années n’ont pas manqué de débats sur la fiscalité (Taxe carbone, TVA sociale, taxe sur les transactions financières et tranche à 75%). A l’heure où l’ensemble de la gauche d’opposition, sociale et politique, se mobilise pour une « révolution fiscale » contre les cadeaux fiscaux faits au patronat et l’alourdissement des impôts pesant sur les salariés et les classes défavorisées, il faut procéder à une réflexion globale sur les finances de l’Etat, des collectivités locales, et mais aussi celles des services publics et de la protection sociale.
Ces questions interrogent le projet alternatif dont nous sommes porteurs ; nos propositions doivent dépasser les enjeux du moment et le cadre d’une société capitaliste, même sociale-démocrate, pour proposer un dispositif et des mesures qui intègrent les éléments d’évolution favorisant une transition vers l’autogestion.
La finalité des dépenses publiques
Au niveau des états et des collectivités territoriales, il s’agit avant tout de financer les services permettant à une société de vivre ensemble : établir les règles de fonctionnement et veiller à leur application c’est-à-dire les fonctions « régaliennes », consistant à faire la loi, maintenir l’ordre et la sécurité extérieure, rendre justice et battre monnaie.
Sous l’effet de la complexification de nos sociétés, les pouvoirs publics ont été conduits à s’intéresser à d’autres domaines: la cohésion sociale, la création et la gestion des biens et services collectifs, la régulation de la vie économique.
Le budget est ainsi devenu un outil d’animation des politiques et s’il paraît évident que les fonctions dites « régaliennes » sont au service collectif de tous les citoyens, les budgets publics ne sont pas pour autnat neutres et traduisent un rapport de forces entre les classes :
- La cohésion sociale vise à la réduction des inégalités (progressivité de l’impôt, dégrèvements, impôt négatif, etc.) mais constitue également une assurance contre les grèves, révoltes et révolutions.
- Les biens et services collectifs profitent certes aux particuliers sous forme de consommation individuelle ou collective, mais aussi aux entreprises via les avantages « externes » dont elles bénéficient dans le processus de production (transports publics, formation de la main d’oeuvre etc…)
Quant à la régulation de la vie économique, elle bénéficie directement au processus de production et d’échange (régulation conjoncturelle à travers la gestion du solde budgétaire, action sur le coût du travail, protection des producteurs nationaux par des droits de douane etc.)
Critique des principes en place
La fiscalité française est fondée sur le principe de non affectation des recettes. L’impôt sur le revenu, la TVA, l’impôt sur les bénéfices comme les timbres fiscaux et les divers impôts sur le patrimoine sont mis dans un pot commun.
Au niveau des budgets publics, recettes et dépenses sont ainsi totalement séparées et ne sont jamais mises en face l’une de l’autre (sauf de façon marginale par les budgets annexes). C’est un principe de solidarité nationale qui certes évite les revendications catégorielles mais permettent également de cacher les transferts de catégorie sociale à catégorie sociale (notamment des pauvres vers les riches).
C’est un principe qui ne facilite pas non plus le contrôle et l’implication des usagers dans les décisions.
Dans les dernières décennies les redevances pour utilisation des services publics ont crû et se sont multipliées (Redevances aériennes, péages routiers, frais d’inscription, forfait judiciaire, etc.)
La vieille concession de travaux publics fait son retour sous le terme plus moderne de Partenariat Public/Privé, tandis que le secteur marchand gère de plus en plus de service publics (en concession comme les autoroutes, aéroports etc., ou sous contrat comme la santé, l’action sociale et le service aux personnes, l’éducation, la production/distribution d’énergie etc.).
La gestion commerciale commence même dans certains pays à envahir les fonctions régaliennes (construction-gestion de prisons, intendance militaire, prélèvement de l’impôt etc.) comme elle l’était sous la monarchie.
Repenser la fiscalité
Nous devons au préalable réaffirmer :
- que la fiscalité n’a pas pour but de corriger les inégalités ni de redistribuer les revenus
- qu’elle ne peut plus généralement remplacer des politiques actives (notamment en matière de reconversion écologique) mais seulement les accompagner et les compléter.
La solidarité dont nous nous réclamons doit être recherchée dans la répartition primaire des revenus (limitation de l’échelle des salaires, limitation / suppression des profits et des rentes, uniformité des allocations) et dans la gratuité des services essentiels.
Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Le rôle redistributif de la fiscalité et des dépenses publiques perdurera et pourra même être affirmé, tout en préparant sa disparition par une politique des revenus, le développement de services communs et de la gratuité.
Participation et contrôle citoyens
Sans remettre en cause le principe général de non affectation des recettes gage de la solidarité nationale, cela implique de particulariser certaines catégories de dépenses publiques dotées de budgets spécifiques, comme c’est déjà le cas pour la protection sociale (santé, retraite, chômage) et les établissements et entreprises publiques, et de prévoir leur gestion démocratique.
Quelques pistes
Pour les fonctions « régaliennes » et de cohésion sociale
- la progressivité des prélèvements sur les revenus et bénéfices, sur la richesse et sur les consommations (si tenté que cela soit techniquement faisable)
- le prélèvement à la source, quitte à appliquer des régularisations, est plus en phase avec la réalité, donc plus facile à gérer pour le contribuable et rend plus compliquée la mise en place de niches fiscales
- l’individualisation de l’impôt (suppression du quotient familial)
le financement de la protection sociale peut se partager entre l’imposition de la plus value (salaires, profits et rente) et la solidarité nationale au titre de la cohésion sociale ; la proportionnalité actuelle doit céder le pas à une forme, même limitée de progressivité (mais attention aux effets pervers).
Les politiques sectorielles et d’orientation de l’économie :
- financement de l’intervention économique par les entreprises (solidarité inter-entreprises à travers une caisse autonome)
- financement des politiques d’orientation de la production par des taxes sur la consommation (comme la TIPP qui pénalisant l’usage du pétrole peut être affecté, sur un budget spécifique, au financement des réseaux ferrés ou aux économies d’énergie)
- comme outil de politique publique, remplacer systématiquement les niches et déductions fiscales inégalitaires et inamovibles, par des aides directes à caractère universel et accordées sans condition de ressource.
Le financement des biens et services collectifs doit rester divers et adapté à chaque usage : fiscalité directe et progressive, taxes sur les consommations, redevances (comportant éventuellement un barème fondé sur des critères sociaux)
Une gestion démocratique
- Créations d’agences spécialisées avec représentants des usagers et de la collectivité
- budgets participatifs impliquant citoyens, salariés et usagers
C’est dans le cadre ainsi défini que l’on doit inclure la lutte pour la justice fiscale passant par un alignement la fiscalité du capital sur celle du travail et l’augmentation de la fiscalité directe (impôts sur le revenu, sur la fortune, sur les profits) et baisser la TVA.
Les conditions politiques
Le financement d’une politique alternative de transformation sociale et de reconversion écologique relève d’une lutte de classes dans un environnement réglementaire mondial favorable aux possédants. Pour gagner cette bataille il faudra savoir lutter contre la fraude, la concurrence fiscale, l’optimisation et l’évasion fiscales. Et pour cela il faudra s’affronter au libéralisme européen et mondial, aux règles de l’OMC et de l’Union Européenne.
La désobéissance à ces est un impératif. La lutte contre la fraude et l’évasion nécessite en effet un contrôle des mouvements de capitaux, une rupture avec la concurrence au moins disant fiscal, la révision des accords bilatéraux qui sous couvert d’éviter la double imposition des sociétés oeuvrant dans plusieurs pays, leur permet de choisir le régime fiscal le plus favorable. Il faudra se doter d’armes de dissuasion comme l’exclusion unilatérale des paradis fiscaux des « bénéfices » de la clause de la nation la plus favorisée. Ou de la liberté de circulation des capitaux.
Il s’agit d’un combat politique, de la volonté de le mener et de trouver des alliés pour le mener, que ce soit en s’appuyant sur les opinions publiques ou sur les États qui y trouveront un intérêt. On ne peut attendre l’unanimité de la communauté internationale pour instaure une taxe Tobin ou un fichier (cadastre) mondial des détenteurs de valeurs mobilières.