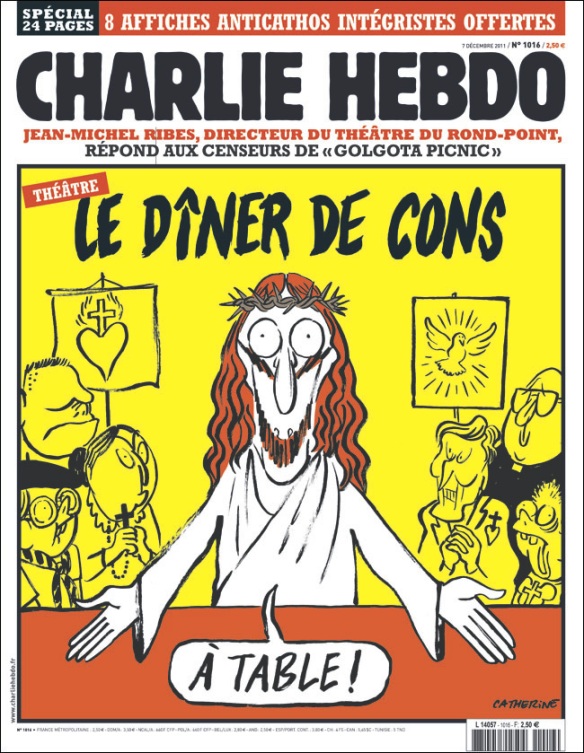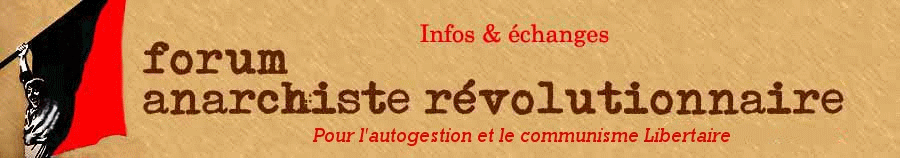Faut-il relire Maurras ? JEAN-PAUL ENTHOVENLe fondateur de l'Action française opère un retour en librairie. Autopsie d'une oeuvre chahutée par l'histoire.
Charles Maurras, ex-académicien, nationaliste et... inspirateur du régime de Vichy.
Rien n'est plus édifiant que de visiter un monument désaffecté. Et de voir comment certaines de ses splendeurs, hier glorifiées, ne sont désormais que colonnes défaites, toiles d'araignée, courants d'air ou éboulis désuets. L'oeuvre de Charles Maurras - pour lequel, entre l'affaire Dreyfus et la "divine surprise" de 1940, trois normaliens sur quatre se seraient fait tuer - illustre, à cet égard, la cruauté du temps qui ronge concepts, idées, doctrines. Un Cahier de l'Herne vient de paraître, consacré à l'actualité de ce poète provençal, antiromantique, théoricien de l'urgence nationale et âme vibrante de cette Action française qui fit trembler la République, tout en étant la lecture favorite du dreyfusard Marcel Proust. Cela mérite une contre-expertise en forme de question : le cadavre de
Charles Maurras bouge-t-il encore ?
Au lendemain de la dernière guerre, les médecins légistes de l'idéologie avaient pourtant constaté l'incontestable décès de cette pensée systématique, colérique, phobique, monarchique - et passablement compromise par les événements. Or, les exégètes rassemblés par L'Herne sont, en majorité, d'un avis contraire. À les en croire, Charles Maurras serait aujourd'hui trop réduit à sa surdité (Gide : "Maurras est un sourd, comme l'Angleterre est une île") et à ses excès. L'époque l'aurait même aplati, simplifié, confondu avec certains de ses partisans qui ne lui ressemblaient guère. On se souvient du jugement du général de Gaulle : "Maurras avait tellement raison qu'il en est devenu fou." Mais devrait-on aller pour autant, comme l'affirme en substance cette défense et illustration, jusqu'à prétendre que Maurras avait raison, même quand il devint fou ?
OrganiqueOn s'en tiendra d'abord aux épisodes dont l'éclaircissement commande une éventuelle indulgence. Pour l'histoire, en effet, Maurras fut surtout l'homme d'une triple méprise : justicier, il choisit sans gêne le camp de l'injustice dans l'affaire Dreyfus ; nationaliste, il consentit à l'abaissement de la nation en 1940 ; germanophobe, il occupa, fût-ce malgré lui, la place de l'"intellectuel organique" de la collaboration avec l'Allemagne. Sur ces trois points fondamentaux, les contributeurs de L'Herne font preuve d'une fidélité embarrassée : ainsi, Maurras n'aurait été antidreyfusard qu'au nom d'une logique dans laquelle l'"antisémitisme de peau" n'entrait pour rien, même si l'"antisémitisme d'État" y avait sa place.
Plaidoirie classique : le faux du lieutenant-colonel Henry était un acte patriotique destiné à contrarier les services d'espionnage allemands et, dans le drame de cette affaire, le "parti de l'étranger" exploita la cause d'un innocent." Si Dreyfus n'est pas coupable, écrivait Maurras, faites-le maréchal, mais fusillez cinquante de ses partisans." Paradoxe injustifiable, mais bizarrement compréhensible pour ceux qui, au nom d'un "nationalisme intégral", tiennent l'individu pour négligeable au regard de la communauté qui le légitime. On doit encore penser de la sorte parmi les islamistes les plus farouches.
VichysteIl se trouve, de plus, que Maurras, malgré son antigermanisme, devint de facto le complice de l'occupant à partir de 1940 et qu'il inspira la "révolution" vichyste. Mais cette évidence ne gêne pas ses lointains épigones, qui nuancent et corrigent : le nationalisme de Maurras aurait été, d'emblée, suspect aux yeux des nazis. Pour preuve, telle longue dépêche du conseiller Schleier, ou telles confidences d'Otto Abetz, dénonçant l'attitude "anti-allemande" de l'auteur de Mademoiselle Monk. Michel Déon, fidèle d'entre les fidèles, se souvient même que son maître, qu'il accompagnait à Lyon en 1942, salua le corps d'un résistant abattu par la Gestapo. Dans l'ordre de la théorie, on pourrait alors résumer cette thèse comme suit : Maurras fut, par son enseignement, le plus solide rempart contre la tentation fasciste d'une génération subjuguée. Sans lui, sans son "politique d'abord", l'infamie eût été plus radicale - et les dérives d'un Drieu La Rochelle, d'un Brasillach, d'un Rebatet ne se conçoivent, précisément, qu'à partir de leurs ruptures avec les principes de ce qu'ils appelaient l'"inaction française". Quant à la fameuse "divine surprise", rien de plus, paraît-il, que ce qui fut espéré par les hommes de la Restauration quand ils durent composer avec les vainqueurs de Waterloo afin d'adoucir les traités de 1815. Cette argumentation, sans grande nouveauté, surprend toujours. Pourtant, j'ai souvent entendu Maurice Clavel - ce résistant dont le journalisme transcendantal devait autant à Maurras qu'à Bernanos ou à Péguy - défendre la même thèse, et s'en servir, mutatis mutandis, pour expliquer comment Lacan (fin lecteur de Maurras) sut retenir par sa position de maîtrise la génération gauchiste des années 70 tentée par le terrorisme. On peut ironiser devant ces sophistications infalsifiables. Il serait injuste de ne pas tenir compte de la dose de vérité qu'elles recèlent.
Demeure l'essentiel : comment peut-on encore être maurrassien ? Et quelle est, à l'heure de la mondialisation et des flux migratoires, la pertinence d'une oeuvre bâtie pour des complexions frileuses ? Sur ce point, L'Herne se contente, avec prudence, de présenter un dossier assez complet : de la condamnation pontificale de 1926 aux polémiques avec Barrès, de l'"empirisme organisateur" au "catholicisme sans la foi", de Frédéric Mistral à Léon Daudet, de Pierre Boutang à Jacques Bainville ou Daniel Halévy, du prisonnier de Clairvaux au disciple d'Auguste Comte. Il en ressort un Maurras hypostasié en réincarnation de Socrate - le Socrate de l'Apologie, bien sûr, le martyr des démocrates. Ce fantasme est indestructible. Et, heureusement, inoffensif.
GéostratégiqueReste qu'on trouvera, dans ce volume, des rappels utiles sur les thèses de certains ouvrages importants - surtout L'avenir de l'intelligence et Kiel et Tanger - où se résument de profondes intuitions maurrassiennes. Le premier prend acte, en le déplorant, du "sacre de l'écrivain", de ce moment où l'intellectuel, devenu par l'"alliance du sang et de l'esprit" le vrai successeur des Bourbons, vide le pouvoir de sa légitimité spirituelle. Quant à Kiel et Tanger, incontestable chef-d'oeuvre de lucidité géostratégique, il contient depuis 1905 les principes qui semblent avoir triomphé dans la Constitution de la Ve République : n'y est-il pas démontré, entre autres, qu'une démocratie ne peut avoir de politique extérieure puisque les raisons du dedans y commandent toute action au-dehors ? D'où cette monarchie gaullienne qui, par ruse de l'histoire, n'aurait certainement pas déplu au Maurras condamné à la Libération.
De ce voyage étrange au pays d'hier on reviendra donc intrigué et sceptique. N'étaient les fâcheux relents d'une rhétorique révolue - où les "loges", la "ploutocratie" ou l'"entropie égalitaire" surgissent comme autant de déplaisants vestiges -, il y a là, malgré tout, une pensée puissante. On y perçoit, comme un vacarme éteint, un peu de la fascination qu'elle exerça à l'époque où il suffisait, dit-on, de lire L'Action française du jour afin de connaître l'esprit du lendemain. Pour le reste, cette "arche nouvelle, catholique, hiérarchique et classique", voguant sur une mer oubliée, semble avoir quelques sérieuses brèches dans sa coque.
A lire" Maurras ", cahier dirigé par Stéphane Giocanti et Axel Tisserand (L'Herne, 392 p., 39 E).
" La bonne mort ", de Charles Maurras, préfacé par Boris Cyrulnik (L'Herne, 80 p., 9,50 E).
" L'Action française ", de François Huguenin (Perrin, coll. " Tempus ", 686 p., 12 E).