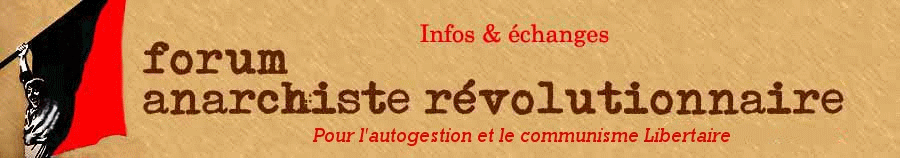Contribution aux discussions sur la répression antiterroristeCe texte est issu d’un processus de discussions collectives. Loin de se limiter à une critique de la défense publique des « inculpés de Tarnac », il affirme des positions sur les formes de luttes actuelles. Nous pensons continuer ce débat et élargir cette élaboration collective. Envoyez vos textes, commentaires et autres contributions sur ce mail :
alleztrincamp@riseup.net.
« Tarnac » est le nom d’une opération médiatico-policière qui a fait beaucoup de bruit. A cette occasion des discours publics ont été tenus par les comités de soutien, les proches ou certains inculpés. Discours qui, in fine, portent des positions politiques. Beaucoup de ces discours nous ont gênés, voire nous ont foutu la rage. Pour plein de raisons différentes. Nous en expliquons certaines ici pour clarifier et partager les discussions qu'on a pu avoir. Aussi, parce que les réflexions au sujet de Tarnac sont valables pour bien d'autres situations de répression et de lutte.
Ce dont nous parlons dans ce texte, c'est du « discours public » concernant la répression, c'est-à-dire de ce qui se dit et s'écrit publiquement au-delà des aspects juridiques d’une affaire. Il ne s'agit pas du tout de parler ici de ce qu'on dit, ou pas, devant un juge. L’articulation entre les éléments juridiques et le discours public qu’on tient sur une affaire n’a rien d’évident, c’est un nœud toujours assez complexe. Pour autant, nous sommes persuadés qu’il est nécessaire de construire un discours public qui ne soit pas entièrement dicté par la défense juridique. Tout en gardant bien à l’esprit que les discours publics affirment des positions politiques qui vont au-delà d’une situation particulière de répression.
Face à la répression, pas facile de réussir à se positionner, à trouver comment construire un rapport de force face à l’Etat dans une situation où on est souvent affaibli. Ces questions ont toujours existé à l’intérieur des mouvements parce qu’on cherche à chaque fois des moyens de faire face à ces situations sans s’y perdre. Il nous semble pressant d’alimenter ce débat, de contribuer à élaborer des discours publics à tenir face à ces situations. Des discours qui ne soient pas en contradiction avec ce que l’on pense, ce que l’on porte, et qui puissent trouver écho chez d’autres personnes subissant elles aussi la répression.
Nécessaire aussi de réfléchir aux modes de diffusion de nos discours. La stratégie médiatique autour de « Tarnac » nous pose problème, même si nous n’avons pas de position de principe contre le fait d'intervenir dans les grands médias. La plupart du temps, ce sont les médias qui ont toutes les cartes en main, et leurs intérêts ne sont jamais les nôtres. Lorsqu’ils ne relaient pas mot pour mot le discours de l’Etat, ils ne font au mieux que dénoncer certains abus d’un pouvoir tout en le légitimant. Ils s’emparent de certains aspects des affaires au gré de leurs intérêts politiciens et économiques. D’où l’importance de chercher des modes collectifs d’intervention dans les médias qui ne répondent pas à l’urgence des flashes TV et des unes quotidiennes. Et qui s’inscrivent dans le cadre d’un rapport de force permettant que le contenu de notre discours ne soit pas complètement altéré. Par exemple, perturber une émission radio en y intervenant en direct. Faute de quoi, mieux vaut utiliser nos propres moyens de communication et tenter de donner par nous-mêmes de la consistance à nos solidarités.
Les discours publics qu’on tient doivent pouvoir être compris et partagés avec d’autres gens. D’où le besoin de se demander : sur quelles bases veut-on tisser des liens de solidarité avec des personnes accusées ? Si nous sommes solidaires, ce n’est pas parce que des personnes subissent des procédures dites exceptionnelles comme l’antiterrorisme, mais parce que l’antiterrorisme est un élément parmi d’autres de la justice de classe, cette justice qui œuvre pour défendre les intérêts des possédants. Ce n’est pas non plus parce que des personnes accusées ont un mode de vie particulier, ni parce qu’elles appartiennent à une soi-disant « mouvance » (type « anarcho-autonome ») ; car ces entités renforcent les séparations. Au contraire, si nous sommes solidaires, c’est parce que des pratiques, des actes de révolte, qui appartiennent aux luttes, au mouvement social, sont attaqués. Le but étant de les rendre inoffensifs en les enfermant dans le cadre institutionnel.
* * *
Antiterrorisme
Certains n'ont pas manqué de critiquer l'usage de l'outil antiterroriste, en raison de la disproportion entre le moyen utilisé et la nature des infractions poursuivies en avançant, par exemple, pour « l'affaire Tarnac », qu'il s'agissait de simples sabotages et non d'attentats. D'autres ont remis en cause l'existence même de cette législation qui serait contraire aux principes du droit démocratique. Des personnes, enfin, voient dans l'antiterrorisme et dans l'état d'exception devenu permanent un véritable « mode de gouvernement ». Toutes ces critiques ont en commun de présenter cette juridiction comme un extraterrestre, une exception dans le droit. Pourtant, l’antiterrorisme se distingue moins qu’il n’y paraît des autres procédures juridiques.[1]
Dans les cas de l'association de malfaiteurs, du trafic de stupéfiants, des bandes organisées… les gardes à vue peuvent aussi durer 4 jours[2], la préventive est difficile à éviter et souvent longue, les peines encourues sont alourdies. Ces pratiques de répression, présentées comme des juridictions d'exception, sont en réalité couramment utilisées. Par ailleurs, d’autres catégories construites par l’Etat subissent elles aussi une répression féroce. Par exemple, les sans-papiers peuvent subir un contrôle d’identité de 32 jours en centre de rétention. Ils peuvent aller en prison pour avoir refusé d’embarquer, puis retourner au centre de rétention avant d’être expulsés. Et dans les faits, la juridiction antiterroriste n'entraîne pas forcément une répression plus importante que les juridictions communes. Même en antiterrorisme, les gardes à vue peuvent durer moins de 6 jours, il arrive que des personnes sortent de préventive avant leur procès, et, si les peines encourues sont souvent très élevées, cela ne veut pas dire que les juges vont les appliquer telles quelles.
Les procédures antiterroristes construisent des accusations sur la base d’intentions supposées, qu’elles soient ou non suivies d’actes. Précisons qu’en antiterrorisme comme dans tout le droit pénal, les intentions doivent toujours être étayées par des éléments matériels. Plus l’intention est prépondérante dans l’accusation, plus des éléments matériels anodins pourront être utilisés à charge. Ces derniers, pris isolément, ne constituent pas nécessairement des infractions. Ce peut être la possession d’un pic à glace, un coup de fil passé à telle personne, avoir de l’argent en liquide… Mais accuser une personne de se préparer à commettre tel ou tel délit avant même sa réalisation est une pratique courante dans tout le droit pénal. Ainsi une personne peut être inculpée de complicité dans la préparation d’un meurtre qui n’a jamais eu lieu. Les intentions sont toujours prises en compte dans les condamnations : homicide volontaire ou involontaire, intention, ou pas, de voler, dégradations volontaires…
La spécificité de l’antiterrorisme tient dans le fait que le pouvoir attribue aux personnes accusées des intentions à caractère politique. Il s’agit, en France, d’avoir « pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». En Europe, c’est, entre autres, « gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale ». Un même acte peut donc relever soit du droit ordinaire, soit du terrorisme.[3] Cette distinction repose seulement sur le type d’intention attribuée aux personnes inculpées : une infraction peut devenir un acte terroriste si les juges estiment que ses motivations sont politiques, au sens où elles s’attaquent à l’Etat dans ses fondements[4]. À trop souligner les particularités de l'antiterrorisme, on risque, même sans le vouloir, d'enfermer les quelques centaines de personnes qui subissent cette répression dans un cercle restreint. De renforcer une catégorie dont le pouvoir souhaite l'existence : celle des « terroristes ». Or cette étiquette, comme bien d'autres, sert à isoler, à faire en sorte que la répression antiterroriste soit perçue comme quelque chose de très spécifique, ce qui empêche d'élargir la solidarité à d'autres situations de répression.
Dans les imaginaires, le « terroriste », c'est l'homme sans visage toujours prêt à poser une bombe à clous au milieu de la foule. En réalité, les procédures antiterroristes correspondent à de multiples situations différentes, qui parfois n’ont d’ailleurs pas grand-chose à voir entre elles et sont dissemblables en leur sein même : des activités séparatistes basques ou corses, des actions contre les radars, des activités attribuées à ce que l’Etat résume sous les appellations « islamiste » ou « anarcho-autonome »… Evidemment, personne ne s'appelle de lui-même « terroriste ». Ce sont les Etats qui collent cette étiquette à ce qui est pour eux opportun de réprimer à un moment donné. Au niveau international, en fonction d'intérêts géopolitiques fluctuants, des organisations peuvent entrer et sortir de listes noires de terroristes. L'ANC (African National Congress) de Nelson Mandela par exemple, a longtemps été classée terroriste par les Etats-Unis avant d'être encensée par tous les démocrates du monde. Les Etats montrent du doigt à certains moments quelques personnes, « ce sont des êtres monstrueux », et vident ainsi de leur sens politique d’origine des actions, des pratiques, des pensées. Ce n'est qu'une manière de désigner un ennemi intérieur à éliminer, contre lequel toute la population devrait se liguer. De fait, en disant « nous ne sommes pas des terroristes » ou « ces gens-là ne sont pas des terroristes », et, à un degré moindre, en disant « nous sommes tous des terroristes », on risque à chaque fois de réactiver et de valider la catégorie « terroriste » qui n'est profitable qu'aux Etats et à ceux qui les soutiennent. Il est problématique tant de se revendiquer du terrorisme que d’être prêt à tout pour s'en démarquer.
Mieux vaut montrer comment cette figure de grand méchant loup est agitée pour faire peur et justifier un contrôle toujours plus fort sur tous : c'est le plan Vigipirate, ce sont les militaires dans les gares, le fichage de nombreuses personnes, les contrôles d'identité de plus en plus fréquents… L'antiterrorisme témoigne et participe de manière spectaculaire d’un durcissement plus général de la législation, réponse à l'accentuation des contradictions sociales. Loin d’être réservé à certaines procédures « d’exception », ce durcissement s’applique au quotidien dans les rues, les commissariats, les tribunaux et les taules : déploiements policiers, relevés ADN systématisés, peines plancher, bracelets électroniques, préventive généralisée, Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs…
L’antiterrorisme est une des multiples formes de répression utilisées quotidiennement par le pouvoir. Elle obéit aux mêmes logiques : la classe dominante édicte les lois, décide de ce qui est légal et de ce qui ne l’est pas selon ses intérêts. L’appareil policier et juridique vise à maintenir l’ordre capitaliste en enfermant une partie des « classes dangereuses » pour mieux contraindre tous au travail. C’est pourquoi la justice condamne autant les actes que les profils sociaux des accusés, souvent en fonction de leur supposée dangerosité. Moins une personne a les moyens de présenter des garanties sociales et économiques, plus elle risque la prison. La justice doit reposer sur cette certitude selon laquelle les flics disent vrai et les pauvres sont coupables. On ne se fait de toute façon aucune illusion sur la possibilité de l’existence d’une justice équitable, d’un Etat de droit qui défendrait les intérêts de chacun. La procédure antiterroriste est à évoquer comme un des outils du pouvoir face à ce qui le met en cause, pour écraser, stigmatiser ceux qui ne se soumettent pas assez à son goût.[5]
Ni coupable, ni innocent
A la lecture d’articles de presse ou de rapports de police, on comprend que l’objectif est de construire soit des profils de coupables, soit des profils d’innocents. La question principale devient alors : « Est-ce qu’il ou elle aurait pu faire ou même penser à commettre tel ou tel acte ? ». Beaucoup ont dit pour ceux de Tarnac : « Libérez-les parce qu’ils sont innocents ». Il semble important de s’extraire de ces considérations de flics et de juges, de ne pas réclamer la libération de personnes sur la base de leur innocence, mais de demander leur remise en liberté indépendamment de la question de leur innocence ou de leur culpabilité. Question qui nous importe peu puisqu’elle ne conditionne pas l’expression de notre solidarité. Pour autant, critiquer l’interprétation à charge de certains faits peut être un enjeu important, par exemple remettre en cause l’appellation de « cellule invisible » utilisée par la justice pour parler des gens de Tarnac[6].
Bien entendu, que des personnes solidaires réclament la libération des inculpés, qu’ils soient coupables ou innocents, n’empêche pas ces derniers de se défendre de leur accusation et de présenter au juge des garanties de représentation (un travail, un logement…). Mais mettre en avant publiquement des profils d’innocents nous conduirait à parler de la personnalité des accusés, de leur parcours de vie, de leurs habitudes, de leur situation… Ce qui non seulement est inintéressant, mais sous-entend en plus qu’il y aurait deux catégories de personnes : « les gens biens », tellement gentils et intégrés qu’ils ne peuvent qu’être innocents, et les autres, évidemment coupables, la plupart du temps appartenant aux « classes dangereuses », c’est-à-dire aux classes populaires.
En plus, s’affirmer solidaires sur la base de l’innocence des accusés et d’une dérive de la justice revient à sous-entendre que la justice devrait agir comme d’habitude, c’est-à-dire condamner les « coupables ». Au final, cela entérine le fonctionnement normal de la justice et en appelle à un Etat de droit.
Enfin, il est problématique de dire que des personnes n’ont pas le profil, qu’elles n’auraient donc jamais pu commettre des actes qui nous semblent prendre part à la conflictualité sociale. C’est affirmer que les personnes n’ont ni le profil socio-économique, ni les idées, les pensées liées aux actes reprochés. Il est évidemment nécessaire de déconstruire le montage policier et médiatique, mais lorsque cela prend toute la place dans le discours public, c’est une position politique : un tel discours conduit, même indirectement, à se démarquer des actes de révoltes. Il risque donc de participer à la logique de l’Etat qui veut, en poursuivant un acte de révolte, discréditer plus largement ce type d’acte. Mieux vaut au contraire se montrer solidaires des actes de révolte et peu importe l’innocence ou la culpabilité des personnes inculpées.
Qui peut payer peut choisir
Dans le cas des inculpés de Tarnac, le discours sur l’innocentisme s’est doublé d’un discours sur les modes de vie. Des affiches de comités de soutien à Tarnac affirment : « Ce qui est attaqué ? Ce sont nos luttes, nos mots, nos modes de vie, nos armes, nos amitiés et la possibilité de s’attaquer à l’ordre des choses… ». La campagne de soutien aux inculpés de Tarnac a mis en avant cette question du mode de vie. On a beaucoup entendu : « soyez solidaires avec nous : si on est attaqué, c'est parce qu'on vit à plusieurs à la campagne ». Or nous ne pensons pas que l’Etat s’attaque aux personnes de Tarnac pour leur « mode de vie ». Cette position nous pose problème à différents niveaux.
D’abord, dans de nombreuses affaires judiciaires, des modes de vie sont construits de toutes pièces. Pouvoir et médias créent l'image qui leur est utile. La caricature de la manière de vivre est la base de tout fait divers. Ainsi, les personnes de Tarnac seraient bizarres car elles vivraient collectivement à la campagne et n'auraient pas de téléphone portable. A l'inverse, l'homme accusé d'appartenir au Fnar (Front national armé révolutionnaire ou Front national anti-radar) serait étrange justement parce qu'il vivait isolé, qu'il habitait seul dans son appartement ! Répondre sur la question des modes de vie, c'est rester sur un terrain dont les médias sont friands sans jamais remettre en cause la portée politique de ces catégories, terrain qui évacue la question des rapports sociaux.
Ensuite, parce que ce discours repose sur une séduction, celle de se voir comme un danger politique. Pourtant, aucun mode de vie n'est en soi subversif. Certes, nous avons besoin d’expérimenter à plusieurs des modes de vie et de repenser ici et maintenant les rapports (genre, exploitation, etc.). Ce peut être tout un tas de débrouilles, d'entraides, de solidarités au quotidien, pour s'en sortir mieux ou un peu moins mal. C’est aussi au cours de luttes des aspects du quotidien qui changent : tout à coup, on s'organise ensemble pour se procurer de la nourriture, pour improviser une cuisine dans l'endroit que l'on occupe, pour défendre cet endroit où l'on va aussi dormir... Pour autant, ce n'est pas parce que l'on mange, cultive, travaille ensemble, ou même possède une maison à 10, que l'on échappe ou attaque les rapports sociaux (c’est-à-dire la propriété privée, l’exploitation). Il n’est pas possible de vivre en-dehors du système capitaliste. Le modèle de l'alternative, cette petite bulle où l'on tente de vivre différemment entre soi, n'entrave en rien le fonctionnement du capital. Alors en faire un modèle politique qui serait la condition pour affronter l’ordre des choses… c’est au mieux une illusion naïve, au pire un mensonge. L’idée d’une existence indépendante de l’économie capitaliste qui pourrait servir de principe politique pour mener des attaques est un leurre. Une mystification qui risque de mener à des communautés closes, de renforcer des codes de l’entre-soi, et de créer des ghettos militants. Ainsi, dans une cour de promenade, un prisonnier dit, au sujet de Tarnac : « Y'a pas mal de leurs idées qui me plaisent, mais le problème, c'est que moi je peux pas vivre à la campagne ! »
Ce discours sur le mode de vie relève en effet d’une manière très particulière d’aborder la politique qui nie les conditions réelles d'existence du plus grand nombre. C'est un point de vue où le moteur serait uniquement le choix : volonté de vivre à plusieurs plutôt que de travailler, d’avoir de l’argent ou au contraire de déclamer qu’il n’existe pas entre nous. Encore faut-il avoir les moyens de faire ce choix. Squatter un logement est souvent une nécessité et la plupart des gens essaient de subir le moins possible l'exploitation. Même si tout le monde fait des choix, c'est avec plus ou moins de marge de manœuvre et avec des conséquences bien différentes. L’argent est justement ce qui permet de s’affranchir des nécessités matérielles, l’espace de respiration pour ne plus y penser. Le problème c'est de faire croire que la volonté serait moteur de toute chose, en niant le contexte, les situations sociales... Or cette position politique consiste justement à faire comme si tout le monde avait tout le temps la même liberté de choisir. « Cette posture [...] relève pour l’essentiel du régime de la liberté marchande : qui peut payer peut choisir »[7].
Elle ne fait que fait que creuser les écarts existants. Elle reconduit les séparations entre les différents segments de classe qui peuvent se rencontrer au sein des luttes. Une telle rencontre n’a certes rien d’évident. Mais la position qui consiste à nier dans le langage les véritables séparations qui structurent la société ne permet pas de les dépasser dans la réalité. Au contraire, à force de les nier, elle les reconduit et risque d’approfondir un peu plus l’incompréhension entre les différents groupes sociaux qui sont amenés à se rencontrer et parfois à s’allier dans les luttes.
Nous pensons au contraire que c’est parce que les séparations, les contradictions sociales sont permanentes que l'apparition de luttes est inéluctable. La rencontre entre les exploités devient alors possible et elle est elle-même un enjeu de la lutte. Rencontre entre tout ceux qui, communément exploités, ne le sont pas de manière égale.
Soigne ta gauche
La défense publique d’un mode de vie nous pose finalement problème en termes de tactique politique, c'est-à-dire dans les alliances qu’elle esquisse. Suivant une tactique double et opportuniste, le discours sur le mode de vie a été utilisé pour séduire, non seulement grâce à l’idée de constituer un danger politique, mais aussi en donnant à tout prix des gages de respectabilité, s’attirant ainsi la bienveillance d’une certaine gauche. Le discours sur le mode de vie devient alors un des opérateurs de sa recomposition.
La récupération de l'affaire de Tarnac par la gauche est particulièrement flagrante. Alors que dès le second jour de l’affaire, les grosses centrales syndicales criaient à la provocation, et Sud[8] au terrorisme, celles-ci ont rapidement rejoint la cohorte des démocrates, des partis et des intellectuels de gauche, tous unis d’une seule voix pour dénoncer « les lois d’exception » incompatibles avec un « Etat de droit démocratique ». Les références au « déni de démocratie » sont même allées jusqu’à une pétition d’intellectuels publiée dans Le Monde appelant à la défense de cette sacro-sainte démocratie. Ceci a de quoi laisser perplexe tant derrière ce terme fourre-tout se cache en réalité un système politique qui mime la défense de l’intérêt de chacun tout en consacrant le pouvoir d’une infime minorité. Ce qui disparaît alors dans cette course à la respectabilité, c'est la possibilité même de créer des liens de solidarité avec tous ceux, qui, attaqués par l'Etat, ne peuvent ni ne veulent donner de tels gages de respectabilité. Avec tous ceux qui, de par leur condition, sont partie prenante de la conflictualité de classe.
Vieilles chimères
Le discours sur le mode de vie crée de nouvelles séparations et s’avère d’autant plus incapable de casser les catégories créées par l’Etat : « jeunes de banlieue », « anarcho-autonomes »... Depuis deux ans de façon récurrente, l'Etat dans ses déclarations médiatiques invoque les anarcho-autonomes comme responsables de « débordements » dans des luttes sociales.
Durant le mouvement contre le CPE, les affrontements violents, notamment devant la Sorbonne, sont attribués dans la presse à des casseurs « anarchistes » ou « autonomes », nécessairement extérieurs au mouvement. La police et les journalistes expliquent que ces affrontements impliquant des milliers de personnes ont été décidés et dirigés par une poignée d'individus. Et c'est tout l'intérêt de la figure de l'anarcho-autonome : incarner à elle seule un ensemble de pratiques collectives illégales (tags, dégradations, affrontements...). Elle crédite aussi la thèse selon laquelle les mouvements sont toujours initiés et contrôlés par une force visible (comme les syndicats) ou obscure (en novembre 2005, les islamistes ont été présentés comme les incitateurs des émeutes de banlieue). Après l'incendie du centre de rétention de Vincennes en juin 2008, l'UMP accuse le Réseau Education Sans Frontières et les collectifs de sans-papiers d'être responsables des révoltes à l'intérieur des centres. De telles manœuvres visent à extraire des luttes sociales certaines pratiques illégales en les attribuant à un extérieur. On voudrait nous faire croire qu’il ne resterait qu'une alternative : la contestation dans un cadre institutionnel ou le « terrorisme ».
L'antiterrorisme n'est qu'un de ces outils dont dispose l'Etat pour contenir la contestation. Tentatives qui à terme semblent vaines, tant les révoltes relèvent d'un fait social qui ne se laissera jamais circonscrire à un groupe, un milieu ou une mouvance.[9]
Sabotage, blocage, conflictualité
En l'occurence, les personnes de Tarnac ont été accusées de sabotages, pratiques que l'on retrouve dans les mouvements sociaux et qui peuvent être l'expression de la conflictualité de classe. Dans cette affaire, on a vu les médias, syndicalistes et politiques effrayés à l'idée que les sabotages des lignes SNCF aient été faits par des cheminots. Quel soulagement lorsque la police affirme avoir arrêté les responsables, soi-disant membres d'une « cellule terroriste ». Rassurés, les représentants homologués du mouvement social se lâchent : « terrorisme » pour Sud Rail, « provocation » pour la LCR qui affirme que « ces méthodes-là n'ont jamais été, ne sont pas et ne seront jamais les nôtres ».
A l'automne 2007, alors que les cheminots protestent contre la casse des régimes spéciaux, des sabotages sont commis sur les voies, contre des systèmes d'aiguillage et des bâtiments administratifs. En 2000, les ouvriers de Cellatex « négocient » le montant de leurs indemnités de licenciement en menaçant de déverser des produits toxiques dans la Meuse et de faire sauter l'usine. Les actes de sabotage sont monnaie courante au travail (vas-y-mollo contre les cadences, travail bâclé après une engueulade avec la hiérarchie, virus informatique balancé sur les ordinateurs...) et ailleurs : le collégien qui fout du chewing-gum dans la serrure pour se dispenser de son exposé de géo, l'automobiliste qui rend inutilisable un radar automatique.
En tant que telles, les pratiques de sabotage n’ont rien d’une doctrine. Elles ne sont pas plus le fait d’excités ou de comploteurs, mais un moyen d’action pertinent (ou pas) au vu des enjeux et des situations. Un même gréviste de la RATP peut faire signer des pétitions, s’asseoir à la table des négociations, tout en s’assurant par le sabotage que les bus ne roulent pas. Dans les mouvements sociaux, cette pratique peut s’accorder avec d’autres types d’actions, comme les assemblées, les occupations, les blocages… qui toutes témoignent d’une recherche d’efficacité, et ne trouvent leur intérêt qu’en fonction du contexte. Considéré de manière isolé, le sabotage ne témoigne pas forcément de la radicalité d’un conflit, il ne s'accompagne pas nécessairement d'une remise en cause plus générale. Les « faucheurs volontaires » emmenés par José Bové ont usé de pratiques illégales dans le seul but de se constituer en lobby anti-OGM et de mieux réformer le droit. Se privant de toute critique du monde qui produit les OGM, il était bien entendu vain de penser pouvoir empêcher leur développement[10].
Légalité ou illégalité ? La question ne se pose pas uniquement en ces termes. Lors des mouvements sociaux, on fait tout simplement ce qui dérange le plus ceux d’en face. « La légalité n’est pas une frontière infranchissable pas plus que l’illégalité une position de principe »[11]. D’ailleurs la légalité de certaines actions dépend très peu des gens en lutte. Une manifestation d’abord légale peut devenir immédiatement illégale sur simple ordre du préfet. Dans les mouvements sociaux, la recherche de formes de lutte efficaces est aujourd'hui d'autant plus pressante que l'arsenal anti-grève se durcit, notamment avec la mise en place du service minimum. Dans les médias, les grèves dans les transports ou l’éducation sont assimilées à des prises d'otages. En 2008, un président jubile (un peu trop vite) devant un parterre de patrons en affirmant : « désormais quand il y a une grève en France personne ne s'en aperçoit ». Le traitement policier et judiciaire des conflits devient la règle. La grève dans ses modalités légales arrive de moins en moins à toucher au portefeuille. Pour des revendications parfois minimes, ceux d’en face n’hésitent pas à utiliser tout l’arsenal du contournement (embauche de précaires, lock out[12]) pour vider les grèves de leur efficacité. Dans ce contexte, certaines pratiques comme les journées d’action et les « temps forts » syndicaux sont parfois désertées. Pas tant parce que ceux qui les initient, gauche et directions syndicales, sont contestées en tant que telles, mais parce que de plus en plus de gens concernés font le constat de leur inefficacité.
D’autres pratiques, de fait illégales et qui ont toujours existé tendent au contraire à se multiplier : grèves sauvages, sabotages, blocages… Ainsi, depuis une quinzaine d’années, les blocages sont devenus en France un enjeu central des mouvements. Il y a évidemment dans la mémoire collective récente le souvenir de décembre 95. Pendant 2 mois pas un train ne roule, « le pays est de fait paralysé. Les métropoles prennent un visage inédit, les rapports sociaux, notamment de solidarité se transforment au quotidien »[11]. En 2003, cette question se repose (comme par exemple le blocage du bac) mais « les contre feux sont là. Les syndicats des transports parviennent à empêcher une extension de la grève aux salariés de la SNCF et de la RATP,[…], la rue a une apparence de normalité, ça roule »[11]. Les enseignements de ces défaites sont tirés par le mouvement du CPE et le mouvement lycéen de 2007 : les blocages des voies et des gares viennent se rajouter aux manifs sauvages. Plus récemment encore, en 2008, les grèves du fret (en Allemagne), grèves sauvages dans l’aviation (Alitalia en Italie)… Et ces pratiques dépassent largement la lutte des cheminots ou des transporteurs. Il suffit de penser aux blocages routiers qui ont fait rage en Guadeloupe… Ces pratiques de blocages ne sont évidemment qu’une des formes de la conflictualité sociale. Comme le disaient des jeunes de la RATP à Paris en 2007 « on veut pas faire une grève juste en mangeant des merguez dans notre dépôt »… Et c’était novembre 2005 qui était cité comme exemple du rapport de force. La conflictualité sociale déborde de toutes parts les médiations démocratiques (partis, syndicats, représentants et associatifs de tout bord) comme on a pu voir en France en novembre 2005 et plus récemment en Grèce à la fin de l’année 2008.
Les mouvements sociaux et les émeutes ne sont pas les seuls moments d’expression de la conflictualité sociale... Ce système ne peut plus promettre l’amélioration des conditions d’existence, mais plutôt leur appauvrissement, comme le confirment encore récemment les conséquences de la crise financière. Dans ces conditions, n’importe quel point de cristallisation des conflits de classe, tels les résistances aux expulsions, aux licenciements, les affrontements avec les flics, sont des foyers aussi nombreux qu’imprévisibles. Logiquement, le pouvoir utilise la répression afin d'isoler ces différentes dynamiques. Lorsque des personnes, des groupes se font réprimer, c'est l'occasion de rappeler que, quels que soient les outils que l'Etat utilise pour attaquer des moyens de lutte, il le fait dans le cadre de la conflictualité de classe dans le but de contenir la contestation le plus largement possible.
* * *
La défense du comité de soutien à Tarnac a organisé son discours public autour de deux points : la défense des inculpés qui seraient attaqués pour leur mode de vie alternatif et la mise en cause de ce qui est décrit comme un nouveau mode de gouvernement, ou une dérive du droit. Ce discours public est parfaitement représentatif des contradictions du cycle des luttes actuelles[13], qui s'expriment encore plus fortement au sein des classes moyennes. Et à bien des égards, ces discours semblent avoir été profilés à leur intention.
Ainsi, le discours sur le mode de vie permet d’affirmer des nouveaux besoins (nouvelles formes de sociabilité, écologie...). Mais, loin d’une perspective communiste car il ne porte aucune critique de fond de la propriété, de l’exploitation et de l’Etat, il se traduit au final par une fuite dans l’alternative. De même pour l’illusion démocrate qui consiste à revendiquer l’abrogation des lois antiterroristes au nom de l’Etat de droit, en bon citoyen vigilant.
En fait, il nous importe moins de dénoncer le machiavélisme raffiné de cette stratégie de défense que de pointer la contradiction sociale dont elle découle. Cette stratégie témoigne de la réelle crise de reproduction que vivent des pans entiers de la classe moyenne - assurés du fait que leurs enfants vivront moins bien qu'eux - et de leur attachement à un rapport de nature garantiste à l’Etat.
Cet appel constant à « l'Etat providence » est le crédo dominant du cycle de lutte actuelle : s'enferrant dans la défense des droits existants et des acquis sociaux, les luttes et les mouvements n’arrivent pas à se dégager d’une stricte réactivité qui consiste à évoquer un contre modèle de stabilité et de sécurité incarné par l’Etat providence et l’Etat de droit. Cette limite s’inscrit dans le cadre de la défaite du mouvement ouvrier, de la restructuration qui s’opère à partir des années 70. Au sein des luttes, le sentiment d’appartenance à la classe s’efface progressivement au profit de la figure du citoyen.
Face à l’appauvrissement des classes populaires au profit du capital et au renforcement de l'arsenal juridique, il ne s’agit pas de délaisser le champ des luttes revendicatives ou de dire que toutes les législations se valent. Il s’agit de prendre acte de l’offensive du capital et de la combattre, sans pour autant s’enfermer dans une défense de l’Etat providence, qui est le prolongement étatique de la restructuration du capital après-guerre.
L’enjeu est de taille car une véritable chape de plomb doctrinale se constitue, prenant notamment appui sur des slogans tels que « nos luttes ont construit nos droits ». Or, ces droits n'ont pas été « conquis de haute lutte » ; ils formalisent un rapport de force à un moment précis (souvent la fin d'une lutte) entre deux positions aux intérêts antagoniques. On fait du droit tel qu'il est le but des luttes sociales passées et non leurs limites mises en forme par l'Etat et le Capital. Cette illusion rétrospective établit que la somme des victoires de la lutte des classes n'est pas autre chose que l'édification lente, laborieuse et linéaire de codes juridiques. Certes des protections, des garanties ont été mises en place à l'issue de ces luttes, mais il s'agit d'avantages restreints et d'aménagements de l'exploitation. Et cela s'est fait au prix du désarmement de l'offensive et reste bien en deçà de ce qui s'y jouait : l'élaboration de solidarités de classe, de pratiques collectives et de contenus subversifs et révolutionnaires.
Les luttes, concrètement, n'ont pas pour objet des droits. Si la Bastille a été prise, ce n'était pas pour obtenir le droit de vote mais parce que c'était un dépôt d'armes. De même, si les mal logés sont en lutte, c'est avant tout pour avoir un logement. La revendication du « droit au logement » est toujours le fait des associations et des partis qui viennent se poser comme seuls médiateurs crédibles et font carrière en négociant par-dessus la tête des collectifs.
Cette position qui réduit tout à la défense du droit empêche donc la ré-appropriation de formes de luttes qui n'ont jamais été inscrites dans le droit mais qui ont toujours appartenu aux mouvements comme la grève sauvage, les auto-réductions, les ré-appropriations collectives ou le sabotage. Nous laissons aux adorateurs du code du travail le choix d'inscrire dans les textes juridiques le droit au refus du travail, à la grève sauvage, à la destruction de machines, au sabotage, à la bastonnade des petits chefs, à l'incendie des usines et à la défenestration des patrons.
Voir dans le droit la finalité de toutes les luttes passées et présentes, empêche tout renversement de perspective qui viserait la critique de l'Etat, de la démocratie et de la propriété privée, non pour les réformer ou les fuir dans un prétendu « en-dehors » mais pour les abolir. S'affirmer solidaires d'actes dénoncés comme irresponsables alors qu'ils ont toujours été des outils de la lutte de classes, réaffirmer par là leur contenu politique et leur appartenance à la conflictualité de classe va dans le sens de ce renversement de perspective.
Notes
1. Nous reprenons ici une grande partie des analyses du texte de Léon de Mattis, « L’antiterrorisme n’est pas une exception », janvier 2009, disponible sur
http://www.leondemattis.net/.
2. Juridiquement, en antiterrorisme, les gardes à vue peuvent durer jusque 6 jours. Mais, la plupart du temps, elles durent 4 jours ou moins.
3. En Espagne, la loi dit que « tout travail en faveur de l’indépendance d’une partie du territoire, même non violente » est traité comme un acte terroriste.
4. Une spécificité propre à l’antiterrorisme concerne la composition des cours d’assises. Ce sont uniquement des magistrats professionnels, dont il est plus aisé d’anticiper le verdict, et non un jury populaire, qui composent les cours d’assises en matière antiterroriste.
5. Sur ces questions, voir « Danse avec l’Etat – Dénoncer l’exception jusqu’à en oublier la justice », mars 2009, L’Envolée no 25, disponible sur
http://reposito.internetdown.org/chroniques/danse.pdf.
6. Lors d’une conférence de presse, le procureur de Paris, Jean-Claude Marin, affirme que les « 9 de Tarnac » appartiennent à une organisation terroriste qu’ils nomment eux-mêmes « Cellule invisible ». En réalité, l’accusation a repris la signature « Comité invisible » d’un livre attribué par les flics à Julien Coupat en remplaçant le mot « comité » par celui de « cellule », terme généralement utilisé pour désigner un groupe membre d’une organisation terroriste. Cette manipulation grossière a ensuite été reprise en cœur par les médias.
7. « Un autre emploi de l’argent », mai 2005, Meeting 2, disponible sur
http://meeting.senonevero.net/.
8. Dès le 12 novembre, Christian Mahieu de Sud Rail a cru bon de mettre en garde « ceux qui frisent la diffamation en voulant confondre terrorisme et action syndicale ».
9. Sur cette question, voir le texte de Léon de Mattis, « Anarcho-autonome », décembre 2008, dans Mauvaises intentions 2, disponible sur
http://infokiosques.net/mauvaises_intentions.
10. Nous faisons la distinction entre les actions spectaculaires des faucheurs volontaires visant à instaurer un dialogue avec l’Etat et les nombreux actes de sabotages anonymes de champs d’expérimentation.
11. La caténaire qui cachait la forêt, novembre 2008, texte disponible sur le site
http://www.collectif-rto.org12. Lors d'un conflit social, la direction choisit de fermer l'usine, et lorsque c'est possible, elle externalise la production.
13. Le texte de conclusion a été en partie influencé par « Le grondement de la bataille et la plainte des pleureuses », avril 2006, Meeting 3, disponible sur :
http://meeting.senonevero.net.