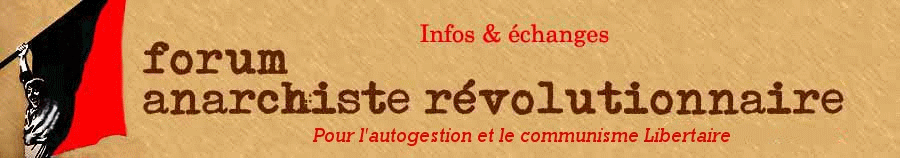Le légalisme, c'est le principe de "loi" (en latin lex, legis) avec "-isme" derrière, c'est-à-dire le principe de sacraliser la loi. La loi est l'un des fondements de ce que Bakounine appelait la transcendance, et que Debord appelle le spectacle : une conceptualisation, une idéalisation du réel, un signe ; et en réalité, un outil bien concret de pouvoir, bien concret.
A mon sens, parler de légal-isme est déjà une lapalissade, car j'estime qu'il n'y a pas de "bonne" loi. On peut tout aussi bien dire que la loi est déjà en soi une aspiration à un "isme", une tentative de transcendance, de conceptualisation globalisante, idéaliste, de la diversité de la réalité. Un plaquage de concepts qui, aussi élaborés qu'ils soient, demeureront toujours trop étriqués pour l'infinie complexité du réel et du vivant, en permanent renouvellement.
Réalité dont la loi, par nature, ne peut tenir efficacement compte puiqu'abstraite, volontairement, du cas particulier. Mais alors, d'où vient l'obsession de faire des lois à appliquer, génériques, au réel ?
Notre système lui-même reconnaît la relativité des lois. Depuis Montesquieu, on sait en effet son rapport évident avec l'exercice d'un pouvoir. Le processus de la loi (passant par trois corps de représentants) se confond en effet avec la succession de son traitement par les trois types de pouvoirs, ce qui montre le lien intime du pouvoir (qui ne se maintient que par la légitimité qu'il impose) et de la loi (qui légitime le pouvoir). Avec d'ailleurs le constat, en système démocratique, de la relativité de la loi et de sa nature d'outil aux mains du pouvoir, puisqu'on reconnaît la nécessité de la séparation des pouvoirs : le corps judiciaire est exprès séparé du corps législateur et du corps exécutif, car l'on sait combien l'interprétation de la loi, qui est et sera toujours possible, peut donner lieu aux abus.
En réalité, cette séparation des pouvoirs n'est qu'une apparence d'évolution par rapport au côté concentré, sacré, absolutiste de la loi monarchique ; elle ne fait qu'atténuer en surface le principe d'autorité, sans pour autant le faire disparaître mais au contraire, pour donner plus de légitimité à son existence profonde, à la domination qu'elle légitime, et inspirer davantage l'obéissance en créant de l'assentiment chez les gens qui la reconnaissent. Cette séparation des pouvoirs correspond socialement à la prise du pouvoir par la classe bourgeoise inspirée des lumières, dont la force consiste en un réseau oligarque, et malgré la concurrence inhérente aux membres de ce réseau, à leur intérêt commun d'asseoir la légitimité de ce qui fait leur force : la propriété privée et monopolistique de l'espace public, et la transaction marchande. les pouvoirs sont séparés, la loi est en apparence contrôlée par des gens différents, mais il suffit de placer aux divers moments de l'élaboration de la loi des amis, et au pire, des gens ayant les mêmes intérêts de classe, afin que se perpétue les principes mêmes de la domination de classe.
La loi n'a toujours été créée qu'en société de domination systématisée d'hommes par d'autres. Les sociétés esclavagistes ont produit les premières lois. La démocratie, née à Athènes, est la légitimation du droit des démotes (les citoyens), minoritaires dans la cité, à exploiter esclaves, femmes et métèques (étrangers). Plus un système consiste en une oppression, plus il a besoin de se légitimer, plus il légifère (il suffit de regarder la prolifération de textes de lois sous Hitler ou Staline).
La loi est si dépendante d'intérêts bien concrets que lorsqu'elle ne leur convient pas, les maîtres la suppriment ou la changent, et ce, toujours en fonction d'un réel bien concret. Croire qu'on peut changer le système de domination de l'homme par l'homme en changeant la loi relève donc au mieux d'une pathétique naïveté, au pire d'un intérêt politico-économique bien compris.
Aussi bien dans le recours à elle que dans son élaboration, la nécessité de produire le masque désincarné d'une loi transcendante... n'apparaît jamais que pour légitimer une décision bien réelle du pouvoir, à appliquer de force à autrui.
La loi est créée dans ce but unique, et ne se donne les apparences de l'abstraction hors du réel, de l'intemporalité et de l'universalité, que pour traiter un genre de cas particuliers, correspondant à des intérêts, que l'on sacralise.
La loi, c'est toujours le masque du pouvoir.
Pas plus que l'Etat, créé pour garantir son application rigoureuse, la loi n'est neutre ; ni dans sa formation (son vocabulaire et sa création même résulte d'une situation, souvent même d'un rapport de force précis, inscrit dans un temps et un lieu), ni dans son intention (puisqu'elle sert à des gens pour en sanctionner d'autres), ni dans son application (les lois demeurant souvent juste assez souples pour permettre une fourchette d'interprétation). Une loi n'est jamais sacrée, elle est relative, comme tout.
Le légalisme, c'est ne justifier une décision ou une sanction que par la légitimité d'une loi, sans discuter de sa légitimit elle-même. C'est aussi la stratégie, compréhensible mais néfaste à terme car réformiste, d'en appeler à la loi dès que l'on se sent menacé.
Alors que le traitement rationnel d'une situation consiste à justement se souvenir que la raison est toujours relative, que la réalité échappe à toute catégorisation dogmatique. Et qu'une solution est toujours bancale, évolutive, révocable, en fonction de l'évolution du contexte réel, toujours différent.
Prôner par principe le respect de la Loi, c'est inculquer un peu plus le renoncement à chacun. C'est déposséder la société de sa volonté spontanée du vivre ensemble sereinement, c'est nier intrinsèquement sa capacité proverbiale à trouver des solutions adaptées. C'est ne pas faire confiance à l'homme. En inoculant dans la tête de chacun qu'il faut obéir de toute façon à des textes, on tord le cou à la liberté des gens de créer en permanence des solutions adaptées et évolutives. On les déresponsabilise, on les oppose par la méfiance de principe, on les terrorise par la peur du déviant, on les punit, on rompt la confiance. On castre les gens de la possibilité de régler ensemble chaque situation, toujours nouvelle et unique, qui se présente, par nature infiniment complexe. On empêche l'autonomie et la révocabilité de leurs analyses, et de leurs décisions.
J'ai tendance à penser qu'on ne peut certes pas fonctionner ensemble sans conventions plus ou moins tacites ou claires. Mais j'ai tendance à ne pas les sacraliser, à croire ces conventions évolutives. J'ai tendance aussi à préférer des conventions simples et très larges, sur des valeurs simples (mais elles-mêmes à critiquer, inventer et réinventer par les palabres), davantage que sur des fonctionnements ou des solutions figés qu'il faudrait produire systématiquement et auxquelles il faudrait obéir par principe.
L'anarchie, c'est certes se défaire du pouvoir concret de certaines personnes. Mais, on le sait depuis les apports de la psychologie, de la sociologie et de la linguistique, c'est aussi à mon sens se défaire du logiciel de soumission, de consentement à l'ordre donné par le chef... et se défaire aussi du réflexe à produire de l'ordre en endossant soi-même le costume du chef contre autrui. C'est s'extirper du besoin compulsif que nous a inoculé la société bourgeoise, de légiférer et de produire de l'abstraction sur tout et rien, de nous méfier les uns les autres et de nous atomiser, de transformer en marchandages et en dettes les moindres échanges passés entre des gens.
Si comme je le crois, l'anarchie porte en son coeur, le refus de la transcendance, la force de la confiance et de la solidarité qu'inspire paradoxalement l'apprentissage de l'autonomie ; si l'anarchie, c'est tisser ensemble et pour cela, se débarrasser de toutes les formes de commandements mentaux plus ou moins intégrés ou extériorisés que nous exerçons les uns sur les autres ; si c'est mettre en adéquation la fin (une société sans oppression de gens par d'autres) et les moyens ; si c'est toujours réinventer la résistance à l'oppression, pour démasquer l'auorité où qu'elle s'immisce ; alors l'anarchie, c'est aussi s'extirper du légalisme.