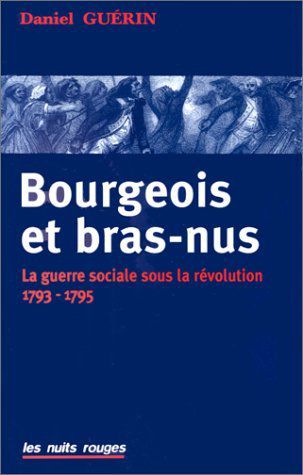Extrait de "La révolution française et nous" de Daniel Guérin :
"Ceux que leurs adversaires affublèrent du nom d’ « enragés » : Jacques Roux, Théophile Leclerc, Jean Varlet, furent en 1793 les interprètes directs et authentiques du mouvement des masses ; ils furent, comme n’hésita pas à l’écrire Karl Marx, « les représentants principaux du mouvement révolutionnaire ».
A ces trois noms doit être attaché celui de Gracchus Babeuf. Il ne s’associe certes que partiellement au mouvement des enragés. Il devait être davantage leur continuateur qu’il ne fut leur compagnon de lutte. Mais il appartient à la même espèce d’hommes (…) Tous quatre étaient des révoltés (…) Tous quatre avaient partagé la grande misère des masses. (…) Au nom de ce peuple qu’ils côtoyaient tous les jours, les enragés élevèrent une protestation qui va beaucoup plus loin que les doléances des modestes délégations populaires. Ils osèrent attaquer la bourgeoisie de front. Ils entrevirent que la guerre – la guerre bourgeoise, la guerre pour la suprématie commerciale – aggravait la condition des bras-nus ; ils aperçurent l’escroquerie de l’inflation, source de profit pour le riche, ruineuse pour le pauvre. Le 25 juin 1793, Jacques Roux vint lire une pétition à la barre de la Convention : « (…) La liberté n’est qu’un vain fantôme quand une classe d’hommes peut affamer l’autre impunément. (…) La république n’est qu’un vain fantôme quand la contre-révolution s’opère de jour en jour par le prix des denrées auquel les trois quarts des citoyens ne peuvent atteindre sans verser des larmes. » (…)
Les enragés eurent le mérite incontestable, face aux montagnards enfermés dans le légalisme parlementaire, de proclamer la nécessité de l’action directe. Ils eurent aussi le courage de s’attaquer aux réputations établies, à la plus haute, à celle à laquelle il était le plus dangereux de toucher. Ils osèrent s’en prendre à l’idole populaire qu’était Robespierre. Théophile Leclerc rangeait ce dernier parmi les « quelques despotes insolents de l’opinion publique ». Jacques Roux dénonçait prophétiquement « les hommes mielleux en apparence, mais sanguinaires en réalité ». (…) La Société des Femmes Révolutionnaires de Claire Lacombe poussa la témérité jusqu’à appeler Robespierre : « Monsieur Robespierre », injure impardonnable à l’époque. »
Note sur Claire Lacombe : « Avant la Révolution, elle avait commencé une assez bonne carrière d’actrice, notamment à Lyon et à Marseille. Au début de 1792, elle monta à Paris et fréquenta les Cordeliers. Le 10 août, elle participa à l’assaut des Tuileries avec un bataillon de Fédérés, ce qui lui valut une couronne civique. Pendant l’hiver 92-93, proche des Enragés (elle fut un temps la compagne de Leclerc), elle milita contre l’accaparement et le chômage. En février 93, elle fonda avec Pauline Léon la Société des Républicaines Révolutionnaires, société exclusivement féminine et très engagée sur le plan social. Le 12 mai, des femmes de cette société demandèrent le droit de porter des armes pour aller combattre en Vendée. Claire Lacombe joua un rôle important pendant les journées du 31 mai et du 2 juin. Elle participa aux délibérations de la Commune et poussa fortement à l’insurrection. En août, elle demanda dans une pétition à la Convention la destitution de tous les nobles de l’armée. Le 5 septembre, elle réclama carrément l’épuration du gouvernement... Les Jacobins s’en prirent alors à elle avec violence, l’accusant de toute sortes de délits : elle aurait volé des armes, caché des aristocrates, etc. Ces accusations n’étaient pas très crédibles, mais elles étaient dangereuses à cette période, et Lacombe se défendit avec force. Elle se présenta le 7 octobre à la barre de la Convention et réfuta les arguments de ses adversaires. Elle osa dénoncer l’oppression dont les femmes étaient victimes, et ajouta : « Nos droits sont ceux du peuple, et si l’on nous opprime, nous saurons opposer la résistance à l’oppression. » Le gouvernement n’apprécia guère, et elle se retrouva quelques jours plus tard impliquée dans une curieuse affaire. Une rixe eut lieu entre des femmes de la Halle et des Républicaines Révolutionnaires. Les premières prétendirent, par la voix d’une députation à la Convention, que les secondes les avaient forcées de prendre le bonnet rouge. Prudhomme, dans les Révolutions de Paris, assura que c’était l’habit masculin que les Républicaines, qui le portaient parfois, avaient voulu forcer les « honnêtes » femmes de la Halle à revêtir. Ces dernières se seraient défendues avec succès, et auraient même fouetté Claire Lacombe, qui participait à l’incident. Le gouvernement révolutionnaire saisit aussitôt le prétexte : les Républicaines Révolutionnaires furent interdites, ainsi que tous les clubs féminins. Lacombe dut se cacher, et la chute des Hébertistes, après celle des Enragés, la mit dans une position inconfortable. Elle fut finalement arrêtée, le 31 mars 1794. Elle demeura un an en prison. Elle reprit ensuite son métier de comédienne, joua en province, puis revint à Paris. On n’a plus de traces d’elle après 1798. »
Le Manifeste des Enragés
25 juin 1793
Délégués du peuple français,
Cent fois cette enceinte sacrée a retenti des crimes des égoïstes et des fripons ; toujours vous nous avez promis de frapper les sangsues du peuple. L’acte constitutionnel va être présenté à la sanction du souverain ; y avez-vous proscrit l’agiotage ? Non. Avez-vous prononcé la peine de mort contre les accapareurs ? Non. Avez-vous déterminé en quoi consiste la liberté du commerce ? Non. Avez-vous défendu la vente de l’argent monnayé ? Non. Eh bien ! Nous vous déclarons que vous n’avez pas tout fait pour le bonheur du peuple.
La liberté n’est qu’un vain fantôme quand une classe d’hommes peut affamer l’autre impunément. L’égalité n’est qu’un vain fantôme quand le riche, par le monopole, exerce le droit de vie et de mort sur son semblable. La république n’est qu’un vain fantôme quand la contre-révolution opère, de jour en jour, par le prix des denrées, auquel les trois quarts des citoyens ne peuvent atteindre sans verser des larmes.
Cependant, ce n’est qu’en arrêtant le brigandage du négociant, qu’il faut bien distinguer du commerce ; ce n’est qu’en mettant les comestibles à la portée des sans-culottes, que vous les attacherez à la Révolution et que vous les rallierez autour des lois constitutionnelles.
Eh quoi ! Parce que des mandataires infidèles, les hommes d’Etat, ont appelé sur notre malheureuse patrie les fléaux de la guerre étrangère, faut-il que le riche nous en déclare une plus terrible encore au-dedans ? Parce que trois cens mille français, traîtreusement sacrifiés, ont péri par le fer homicide des esclaves des rois, faut-il que ceux qui gardaient leurs foyers soient réduits à dévorer des cailloux ? Faut-il que les veuves de ceux qui sont morts pour la cause de la liberté paient au prix de l’or, jusques au coton dont elles ont besoin pour essuyer leurs larmes ? Faut-il qu’elles paient au prix de l’or, le lait et le miel qui servent de nourriture à leurs enfants ?
Mandataires du peuple, lorsque vous aviez dans votre sein les complices de Dumouriez, les représentants de la Vendée, les royalistes qui ont voulu sauver le tyran, ces hommes exécrables qui ont organisé la guerre civile, ces sénateurs inquisitoriaux qui décrétaient d’accusation le patriotisme et la vertu, la section des Gravilliers suspendit son jugement... Elle s’aperçut qu’il n’était pas du pouvoir de la Montagne de faire le bien qui était dans son coeur, elle se leva...
Mais aujourd’hui que le sanctuaire des lois n’est plus souillé par la présence des Gorsas, des Brissot, des Pétion, des Barbaroux et des autres chefs des appelants, aujourd’hui que ces traîtres, pour échapper à l’échafaud, sont allés cacher, dans les départements qu’ils ont fanatisés, leur nullité et leur infamie ; aujourd’hui que la Convention nationale est rendue à sa dignité et à sa vigueur, et n’a besoin pour opérer le bien que de le vouloir, nous vous conjurons, au nom du salut de la république, de frapper d’un anathème constitutionnel l’agiotage et les accaparements, et de décréter ce principe général que le commerce ne consiste pas à ruiner, à désespérer, à affamer les citoyens.
Les riches seuls, depuis quatre ans, ont profité des avantages de la Révolution. L’aristocratie marchande, plus terrible que l’aristocratie nobiliaire et sacerdotale, s’est fait un jeu cruel d’envahir les fortunes individuelles et les trésors de la république ; encore ignorons-nous quel sera le terme de leurs exactions, car le prix des marchandises augmente d’une manière effrayante, du matin au soir. Citoyens représentants, il est temps que le combat à mort que l’égoïste livre à la classe la plus laborieuse de la société finisse. Prononcez contre les agioteurs et les accapareurs. Ou ils obéiront à vos décrets ou ils n’y obéiront pas. Dans la première hypothèse, vous aurez sauvé la patrie ; dans le second cas, vous aurez encore sauvé la patrie, car nous serons à portée de connaître et de frapper les sangsues du peuple.
Eh quoi ! Les propriétés des fripons seraient-elles quelque chose de plus sacré que la vie de l’homme ? La force armée est à la disposition des corps administratifs, comment les subsistances ne seraient-elles pas à leur réquisition ? Le législateur a le droit de déclarer la guerre, c’est-à-dire de faire massacrer les hommes, comment n’aurait-il pas le droit d’empêcher qu’on pressure et qu’on affame ceux qui gardent leurs foyers ?
La liberté du commerce est le droit d’user et de faire user, et non le droit de tyranniser et d’empêcher d’user. Les denrées nécessaires à tous doivent être livrées au prix auquel tous puissent atteindre, prononcez donc, encore une fois... les sans culottes avec leurs piques feront exécuter vos décrets.
Vous n’avez pas hésité à frapper de mort ceux qui oseraient proposer un roi, et vous avez bien fait ; vous venez de mettre hors la loi les contre-révolutionnaires qui ont rougi, à Marseille, les échafauds du sang des patriotes, et vous avez bien fait ; vous auriez encore bien mérité de la patrie, si vous eussiez expulsé de nos armées les nobles et ceux qui tenaient leurs places de la cour ; si vous eussiez pris en otage les femmes, les enfants des émigrés et des conspirateurs, su vous eussiez retenu pour les frais de la guerre les pensions des ci-devant privilégiés, si vous eussiez confisqué au profit des volontaires et des veuves les trésors acquis depuis la révolution par les banquiers et les accapareurs ; si vous eussiez chassé de la Convention les députés qui ont voté l’appel au peuple, si vous eussiez livré aux tribunaux révolutionnaires les administrateurs qui ont provoqué le fédéralisme, si vous eussiez frappé du glaive de la loi les ministres et les membres du conseil exécutif qui ont laissé former un noyau de contre-révolution à la Vendée, si enfin vous eussiez mis en état d’arrestation ceux qui ont signé les pétitions anti-civiques, etc., etc. Or les accapareurs et les agioteurs ne sont-ils pas autant et plus coupables encore ? Ne sont-ils pas, comme eux, de véritables assassins nationaux ?
Ne craignez donc pas de faire éclater sur ces vampires la foudre de votre justice ; ne craignez pas de rendre le peuple trop heureux. Certes, il n’a jamais calculé lorsqu’il a été question de tout faire pour vous. Il vous a prouvé, notamment dans les journées du 31 mai et du 2 juin, qu’il voulait la liberté toute entière. Donnez-lui en échange du pain, et un décret ; empêchez qu’on ne mette le bon peuple à la question ordinaire et extraordinaire par le prix excessif des comestibles.
Jusques à présent, les gros marchands qui sont par principe les fauteurs du crime, et par habitude les complices des rois, ont abusé de la liberté du commerce pour opprimer le peuple ; ils ont faussement interprété cet article de la déclaration des droits de l’homme qui établit qu’il est permis de faire tout ce qui n’est pas défendu par la loi. Eh bien ! décrétez constitutionnellement que l’agiotage, la vente de l’argent-monnaie, et les accaparements sont nuisibles à la société. Le peuple qui connaît ses véritables amis, le peuple qui souffre depuis si longtemps verra que vous vous apitoyez sur son sort, et que vous voulez sérieusement guérir ses maux ; quand on aura une loi claire et précise, dans l’acte constitutionnel, contre l’agiotage et les accaparements, il verra que la cause du pauvre vous tient plus à cœur que celle du riche ; il verra qu’il ne siège point parmi vous des banquiers, des armateurs, et des monopoleurs ; il verra enfin que vous ne voulez pas la contre-révolution.
Vous avez, il est vrai, décrété un emprunt forcé d’un milliard sur le riche ; mais si vous n’arrachez pas l’arbre de l’agiotage, si vous ne mettez un frein national à l’avidité des accapareurs, le capitaliste, le marchand, dès le lendemain, lèveront cette somme sur les sans-culottes, par le monopole et les concussions ; ce n’est donc plus l’égoïste, mais le sans-culotte que vous avez frappé ; avant votre décret, l’épicier et le banquier n’ont cessé de pressurer les citoyens ; quelle vengeance n’exerceront-ils pas aujourd’hui que vous les mettez à contribution ? quel nouveau tribut ne vont-ils pas lever sur le sang et les larmes du malheureux ?
En vain objecterait-on que l’ouvrier reçoit un salaire en raison de l’augmentation du prix des denrées, la vérité il en est quelques-uns dont l’industrie est payée plus cher ; mais il en est aussi beaucoup dont la main d’œuvre est moins salariée depuis la Révolution. D’ailleurs tous les citoyens ne sont pas ouvriers ; tous les ouvriers ne sont pas occupés, et parmi ceux qui le sont, il en est qui ont huit à dix enfants incapables de gagner leur vie, et les femmes en général ne gagnent pas au-delà de vingt sous par jour.
Députés de la Montagne, que n’êtes vous montés depuis le troisième jusqu’au neuvième étage des maisons de cette ville révolutionnaire, vous auriez été attendris par les larmes et les gémissements d’un peuple immense sans pain et sans vêtements, réduit à cet état de détresse et de malheur par l’agiotage et les accaparements, parce que les lois ont été cruelles à l’égard du pauvre, parce qu’elles n’ont été faites que par les riches et pour les riches.
O rage, ô honte du XVIIIème siècle ! Qui pourra croire que les représentants du peuple français qui ont déclaré la guerre aux tyrans du dehors ont été assez lâches pour ne pas écraser ceux du dedans ? Sous le règne des Sartines et des Flesselles, le gouvernement n’aurait pas toléré qu’on fît payer les denrées de première nécessité trois fois au-dessus de leur valeur ; que dis-je ? Ils fixaient le prix des armes et de la viande pour le soldat ; et la Convention nationale, investie de la force de vingt-cinq millions d’hommes, souffrira que le marchand et le riche égoïste leur portent habituellement le coup de la mort, en taxant arbitrairement les choses les plus utiles à la vie. Louis Capet n’avait pas besoin, pour opérer la contre-révolution, de provoquer la foudre des puissances étrangères. Les ennemis de la patrie n’avaient pas besoin d’incendier d’une pluie de feu les départements de l’Ouest, l’agiotage et les accaparements suffisent pour renverser l’édifice des lois républicaines.
Mais c’est la guerre, dira-t-on, qui est la cause de la cherté des vivres. Pourquoi donc, représentants du peuple, l’avez-vous provoquée en dernier lieu ? Pourquoi, sous le cruel Louis XIV, le Français eut-il à repousser la ligue des tyrans, et l’agiotage n’étendit pas sur cet empire l’étendard de la révolte, de la famine et de la dévastation ? Et, sous ce prétexte il serait donc permis au marchand de vendre la chandelle six francs la livre, le savon six francs la livre, l’huile six francs la livre.
Sous le prétexte de la guerre, le sans-culotte paierait donc les souliers cinquante livres la paire, une chemise cinquante livres, un mauvais chapeau cinquante livres. C’est pour le coup qu’on pourrait dire que les prédictions de Cazalès et de Maury sont accomplies ; dans ce cas, vous auriez conspiré, avec eux, contre la liberté de la patrie, que dis-je, vous les auriez surpassés en trahison. C’est pour le coup que les Prussiens et les Espagnols pourraient dire : nous sommes les maîtres d’enchaîner les Français car ils n’ont pas le courage d’enchaîner les monstres qui les dévorent, c’est pour le coup qu’on pourrait dire : qu’en répandant à propos des millions, qu’en associant les bourgeois et les gros marchands au parti des contre-révolutionnaires, la république se détruirait par elle-même.
Mais c’est le papier ; dit-on encore, qui est la cause de la cherté des vivres : ah ! le sans-culotte ne s’aperçoit guère qu’il y en a beaucoup en circulation... Au reste sa prodigieuse émission est une preuve du cours qu’il a et du prix qu’on y attache. Si l’assignat a une hypothèque réelle, s’il repose sur la loyauté de la nation française, la quantité des effets nationaux ne leur ôte donc rien de leur valeur. Parce qu’il y a beaucoup de monnaie en circulation, est-ce une raison pour oublier qu’on est homme, pour commettre dans les tavernes du commerce des brigandages, pour se rendre maître de la fortune et de la vie des citoyens, pour employer tous les moyens d’oppression que suggèrent l’avarice et l’esprit de parti, pour exciter le peuple à la révolte et le forcer par la disette et le supplice des besoins à dévorer ses propres entrailles ?
Mais les assignats perdent beaucoup dans le commerce... Pourquoi donc les banquiers, les négociants et les contre-révolutionnaires du dedans et du dehors en remplissent-ils leurs coffres ? Pourquoi ont-ils la cruauté de diminuer le salaire de certains ouvriers, et n’accordent-ils pas une indemnité aux autres ? Pourquoi n’offrent-ils pas l’escompte, lorsqu’ils acquièrent les domaines nationaux ? L’Angleterre, dont la dette excède peut-être vingt fois la valeur de son territoire et qui n’est florissante que par le papier de sa banque, paie-telle à proportion les denrées aussi cher que nous les payons ? Ah ! le ministre Pitt est trop adroit pour laisser accabler ainsi les sujets de Georges ! Et vous, citoyens représentants, vous, les députés de la Montagne, vous qui vous faites gloire d’être du nombre des sans-culottes, du haut de votre immortel rocher, vous n’anéantirez pas l’hydre sans cesse renaissante de l’agiotage !
Mais ajoute-ton, on tire de l’étranger bien des articles, et il ne veut en paiement que de l’argent. Cela est faux ; le commerce s’est presque toujours fait par l’échange de marchandise contre marchandise, et du papier contre papier ; souvent même on a préféré des effets au numéraire. Les espèces métalliques qui circulent en Europe ne suffiraient pas, pour acquitter la cent-millième partie des billets qui sont en émission. Ainsi, il est clair comme le jour, que les agioteurs et les banquiers ne discréditent les assignats que pour vendre plus cher leur argent, pour trouver occasion de faire impunément le monopole et de trafiquer dan le comptoir du sang des patriotes, qu’ils brûlent de verser.
Mais l’on ne sait pas comment les choses tourneront. –Il est très certain que les amis de l’égalité ne souffriront pas toujours qu’on les fasse égorger au dehors et qu’au-dedans on les assiège par la famine. Il est très certains que toujours ils ne seront pas les dupes de cette peste publique, des charlatans qui nous rongent comme des vers, des accapareurs dont les magasins ne sont plus qu’un repaire de filous.
Mais, lorsque la peine de mort est prononcée contre quiconque tenterait de rétablir la royauté, lorsque des légions innombrables de citoyens soldats forment avec leurs armes une voûte d’acier, lorsqu’elles vomissent de toutes parts le salpêtre et le feu sur une horde de barbares, le banquier et l’accapareur peuvent-ils dire qu’ils ne savent pas comment les choses tourneront ? Au reste, s’ils l’ignorent, nous venons le leur apprendre. Le peuple veut la liberté et l’égalité, la république ou la mort ; et voilà précisément ce qui vous désespère, agioteurs, vils suppôts de la tyrannie.
N’ayant pu réussir à corrompre le cœur du peuple, à le subjuguer par la terreur et la calomnie, vous employez les dernières ressources des esclaves pour étouffer l’amour de la liberté. Vous vous emparez des manufactures, des ports de mer, de toutes les branches du commerce, de toutes les productions de la terre pour faire mourir de faim, de soif et de nudité, les amis de la patrie, et les déterminer à se jeter entre les bras du despotisme.
Mais les fripons ne réduiront pas à l’esclavage un peuple qui ne vit que de fer et de liberté, de privations et de sacrifices. Il est réservé aux partisans de la monarchie de préférer des chaînes antiques et des trésors à la République et à l’immortalité.
Ainsi, mandataires du peuple, l’insouciance que vous montreriez plus longtemps serait un acte de lâcheté, un crime de lèse-nation. Il ne faut pas craindre d’encourir la haine des riches, c’est-à-dire des méchants. Il ne faut pas craindre de sacrifier les principes politiques au salut du peuple, qui est la suprême loi.
Convenez donc avec nous que par pusillanimité vous autorisez le discrédit du papier, vous réparez la banqueroute, en tolérant des abus, des forfaits dont le despotisme eût rougi, dans les derniers jours de sa barbare puissance.
Nous savons sans doute qu’il est des maux inséparables d’une grande révolution, qu’il n’est pas de sacrifices qu’on ne doive faire, pour le triomphe de la liberté, et qu’on ne saurait trop payer cher le plaisir d’être républicain ; mais aussi nous savons que le peuple a été trahi par deux législatures ; que les vices de la Constitution de 1791 ont été la source des calamités publiques, et qu’il est temps que le sans-culotte qui a brisé le sceptre des rois, voie le terme des insurrections et de toute espèce de tyrannie.
Si vous n’y portez un prompt remède, comment ceux qui n’ont aucun état, ceux qui n’ont que 2, 3, 4, 4 ou 6 cents livres de rentes, encore mal payées, soit en pension viagère, soit sur des caisses particulières subsisteront-ils, si vous n’arrêtez le cours de l’agiotage et des accapareurs, et cela par un décret constitutionnel qui n’est pas sujet aux variations des législateurs. Il est possible que nous n’ayons la paix que dans vingt ans ; les frais de la guerre occasionneraient une émission nouvelle de papier ; voudriez-vous donc perpétuer nos maux pendant tout ce temps-là, déjà trop long, par l’autorisation tacite de l’agiotage et des accaparements ? Ce serait là le moyen d’expulser tous les étrangers patriotes, et d’empêcher les peuples esclaves de venir respirer en France l’air pur de la liberté.
N’est-ce donc pas assez que vos prédécesseurs, pour la plupart d’infâme mémoire, nous aient légué la monarchie, l’agiotage et la guerre, sans que vous nous léguiez la nudité, la famine et le désespoir ? Faut-il que les royalistes et les modérés, sous prétexte de la liberté du commerce, dévorent encore les manufactures, les propriétés ? qu’ils s’emparent du blé des champs, des forêts et des vignes, de la peau même des animaux et qu’ils boivent encore dans des coupes dorées le sans et les larmes de citoyens, sous la protection de la loi ?
Députés de la Montagne, non, non, vous ne laisserez pas votre ouvrage imparfait ; vous fonderez les bases de la prospérité publique ; vous consacrerez les principes généraux et répressifs de l’agiotage et des accapareurs ; vous ne donnerez pas à vos successeurs l’exemple terrible de la barbarie des hommes puissants sur le faible, du riche sur le pauvre ; vous ne terminerez pas enfin votre carrière avec ignominie.
Dans cette pleine confiance, recevez ici le nouveau serment que nous faisons de défendre jusques au tombeau la liberté, l’égalité, l’unité et l’indivisibilité de la République et les sans-culottes opprimés des départements.
Qu’ils viennent, qu’ils viennent bien vite à Paris, cimenter les liens de la fraternité ! c’est alors que nous leur montrerons ces piques immortelles qui ont renversé la Bastille ; ces piques qui fait tomber en putréfaction la commission des douze et la faction des hommes d’Etat, ces piques qui feront justice des intrigants et des traîtres, de quelque masque qu’ils se couvrent et quelque pays qu’ils habitent. C’est alors que nous les conduirons au pied de ce jeune chêne où les Marseillais et les sans-culottes des départements abjurèrent leur erreur, et firent serment de renverser le trône. C’est alors enfin que nous les accompagnerons dans le sanctuaire des lois, où d’une main républicaine nous leur montrerons le côté qui voulut sauver le tyran et la Montagne qui prononça sa mort.
Vive la vérité, vive la Convention nationale, vive la république française !
(D’après Dommanget, Les Enragés contre la vie chère, 1948, p. 83-89)
... https://www.matierevolution.fr/spip.php?article362