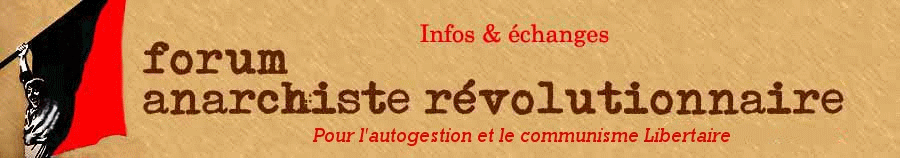Journal d'un employé de Michelin Algérie "vendu comme un pneu"
MichelinLes salariés sont-ils la cinquième roue de la charette Michelin Algérie ?
Lundi 10 juin,
le premier groupe privé algérien, Cevital, annonçait tambour battant la reprise de Michelin Algérie. Chez les employés du leader mondial français de pneumatique, la surprise est brutale. L'un d'eux a raconté à Maghreb Emergent cette semaine particulière.
Je suis un des 600 salariés de Michelin Algérie qui vient de perdre son emploi. Ou plutôt un des individus impliqués dans « l'accord de partenariat entre Michelin et Cevital prévoyant l'entrée de Cevital dans le capital de la société Michelin Algérie à hauteur de 67 % », comme nous l'a expliqué lundi notre directeur général Igor Zyemit. L'annonce, rapide et courte, a surpris tout le monde. Malgré les signes de ralentissement depuis deux ans, personne ne s'attendait à une telle issue : la fermeture de l'usine de Bachdjerrah, à Alger, et le départ de l'entreprise après 50 ans d'existence en Algérie.
Mardi 11 juin : mascarades
Réveil difficile. Incapable de trouver le sommeil, j'ai passé une partie de la nuit à lire les articles parus sur Internet à notre sujet. La plupart des médias reprennent surtout les propos du PDG de Cevital, Issad Rebrab, tenus la veille au cours d'une conférence de presse animée à Alger avec notre DG. Il déclare que nous serons tous repris par Cevital mais ce n'est pas vrai. Un plan de départ volontaire a été mis en place et seule une petite partie des employés va être gardée. Très soucieuse de son image, Michelin essaye de cacher la réalité d'un licenciement. D'autant que le jour de la nouvelle du rachat par Cevital, on apprenait que 700 de nos collègues français allaient être licenciés suite à la fermeture du site de Joué-lès-Tours. Pour cela, on joue sur les mots. Il ne faut pas parler de « fermeture » mais de « partenariat », surtout ne pas dire « licenciement » mais « plan d'accompagnement personnel », indique une note remise aux cadres de l'entreprise.
Mercredi 12 juin : mobilisation
Les conditions proposées par notre direction sont loin de nous satisfaire. Sauf que nous n'avons pas de syndicat pour défendre nos intérêts. Nous nous sommes donc mobilisés pour faire entendre notre voix malgré l'absence de représentants élus. Nous avons organisé une réunion entre collègues au cours de laquelle nous avons établi les revendications à adresser à notre hiérarchie.
Jeudi 13 juin : l'entretien
Depuis mardi, ont débuté des entretiens individuels. Aujourd'hui c'est mon tour. Je suis reçu par mon directeur accompagné par mon chef de service. Ils commencent par me demander ce que je ressens face à la situation. C'est là que les employés vident leur sac en général. Ensuite, nos supérieurs nous exposent ensuite les trois propositions possibles : travailler sur un site de Cevital à plus de 50 kilomètres ou quitter avec les indemnités. Tout se passe verbalement. On ne nous remet aucun document, ni papier à signer. Pour la suite, rien ne nous a été annoncé mis à part une période de chômage technique à compter du 4 juillet.
Vendredi 14 et samedi 15 juin : insomnies
Tous mes collègues n'ont pas dormi du week-end. Le moral est au plus bas et aucune prise en charge psychologique n'a été prévue. On se confie entre collègues à défaut de pouvoir compter sur le soutien de nos chefs. La direction se contente de nous parler de bureaux d'orientation où le personnel des ressources humaines de Cevital tentera de nous garantir un avenir professionnel. Mais en attendant, nous n'avons toujours pas vu l'ombre d'un gars de Cevital.
Dimanche 16 juin : pneu-humain
L'ambiance n'est pas au travail. A l'usine, tout le monde discute des primes de départ attroupé autour des machines. Chacun y va de son avis. Les plus anciens dénoncent une équivalence d'indemnité avec leurs camarades de dix ans d'ancienneté, quand eux en compte vingt-cinq. On prend aussi des nouvelles de nos collègues de l'usine de Blida. C'est la même situation, personne n'a le cœur à l'ouvrage. Dans les bureaux du service groupe chargé de la partie administrative, les conversations tournent autour des propositions reçues par la direction. Ceux qui ont été « retenus » pour continuer chez Cevital réclament une prime immédiate, et non au bout de deux ans comme annoncé. Ceux qui n'ont pas été choisis préféraient renoncer à leurs indemnités et ne pas se retrouver au chômage. Autre sujet de discussion : l'information rapportée par le journal Reporters.dz selon laquelle l'Etat pourrait s'opposer à la transaction entre Cevital et Michelin en faisant valoir son droit de préemption. Mais on n’y croit pas trop car nos chefs disent ne pas être au courant de la question et le service juridique n'a pas été saisi. C'est vrai que nous, on aurait aimé que Michelin reste en Algérie, même si l'usine était obligée de fermer. Là, on nous a vraiment vendu comme des pneus.
Une tentative d’assassinat d’un syndicaliste à la wilaya de Batna
By admin On 20 juin, 2013
Trouvé par des citoyens hier soir, le 19 Juin 2013 au bord de la route reliant la wilaya de Batna et Ain toutta, à environ 10 kilomètres du centre de gravats, M. Hamza Abd Essamad était menotté et étranglé avec une corde autour de son cou, ces citoyens ont contacté la gendarmerie nationale, où la victime a été immédiatement transféré à l’hôpital de Ain toutta.
Convoqué par la police Batna hier à 14 pour la plainte qui avait portée sur des menaces reçues par téléphone, Abd Essamad a communiqué avec l’un de ses collègues juste après avoir quitté le poste de police de Batna l’informant que la police lui a demandé de renoncer à cette plainte, déterminé à poursuivre les acteurs, il refuse et après quelques minutes la communication se coupe… !
M. Hamza Abd Essamad se trouve dans un état physique et psychologique très grave selon son médecin et sa famille.
Rappelons que ce militant syndicaliste travaillait dans le centre de gravats de la wilaya de Batna, il a fait l’objet de licenciement abusif pour activité syndicale, étant en conflit avec le responsable du centre, il avait reçu des menaces à plusieurs reprise par les proches de ce dernier apprend-on.
M.Idriss
a la suite d'un sit in organisé par le comité des chomeurs pour le logement , violente repression policiere sur les militants, notamment Abdelkader Kherba qui fut arreté, tabassé et enchainé comme un chien par la police avec ses amis militants.